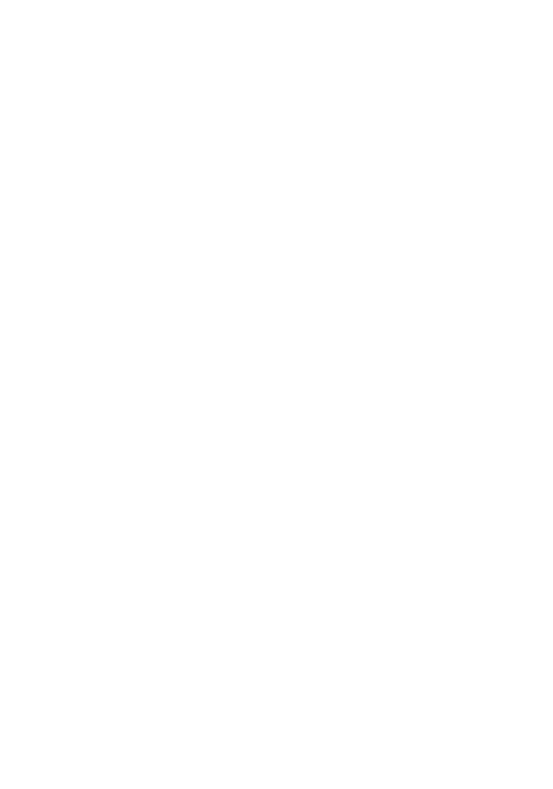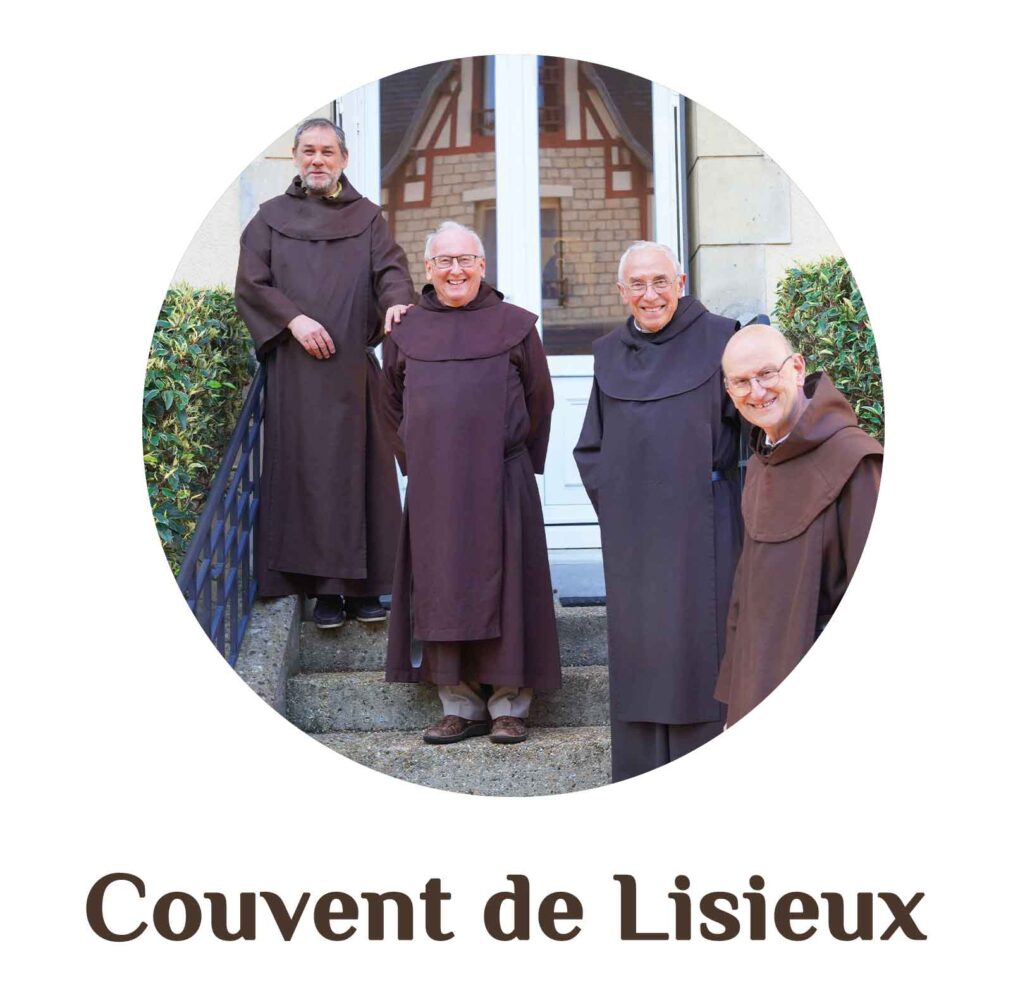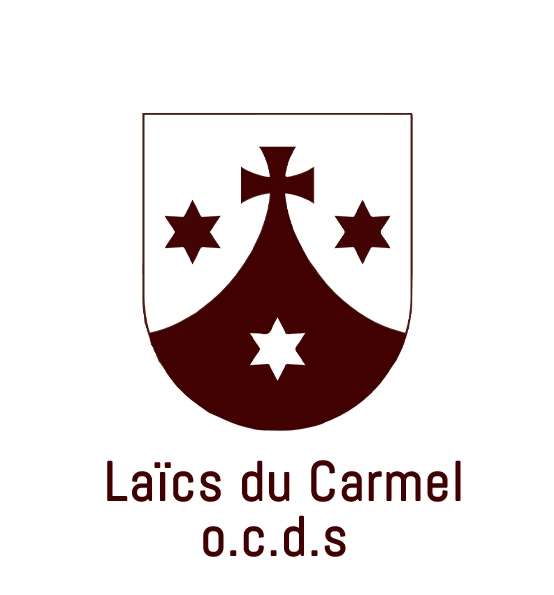Histoire des Carmes déchaux à Paris de 1611 à nos jours …
La réforme du Carmel initiée par Thérèse d’Avila et Jean de la Croix dans l’Espagne du siècle d’Or donne naissance, à la fin du 16ème siècle, à l’Ordre des Carmes Déchaux, O.C.D – le terme « déchaux » renvoie à l’idée de retour à la pauvreté des origines manifesté par le port de sandales aux pieds. Cette nouvelle branche de l’Ordre du Carmel a connu un très rapide essor hors d’Espagne. Cette expansion s’est faite par deux voies différentes.

Tandis que les carmes déchaux vivant en Espagne se répandent vers les territoires de l’empire espagnol jusque dans le Nouveau Monde, les carmes déchaux vivant en Italie sont envoyés en mission sous l’impulsion du pape vers le reste de l’Europe et les territoires de mission ne dépendant pas de la couronne d’Espagne. Un des fondateurs de la « Propaganda Fidae », devenue la congrégation pour l’évangélisation des peuples, responsable aujourd’hui des œuvres missionnaires du Saint Siège, est un carme déchaux d’Italie, Jean de Jésus Marie.
Peu après qu’une communauté a été fondée en 1608 à Avignon dans les États pontificaux, l’Ordre des Carmes déchaussés cherche à s’implanter en France. Thomas de Jésus, carme déchaux espagnol vivant en Italie, Denys de la Mère de Dieu et Bernard de Saint Joseph, premiers carmes déchaux français formés en Italie, arrivèrent dans ce but à Paris. Ils étaient porteurs d’un Bref du pape Paul V destiné au Roi pour cette fondation. Mais le roi Henri IV venait d’être assassiné (14 mai 1610).
Thomas de Jésus, avec l’appui de la Régente Marie de Médicis, obtint l’autorisation épiscopale, avec des Lettres patentes royales, datées de juin 1610. Cependant, le Parlement de Paris fit beaucoup de difficultés et ce n’est qu’au mois de mai 1611 qu’il finit par enregistrer les Lettres patentes de fondation. Les carmes déchaux avaient en effet deux handicaps : ils étaient tout d’abord les derniers venus à Paris parmi les ordres religieux nés au XVIe siècle dans le contexte de la Réforme catholique tridentine. Les Jésuites (1580) et les Capucins (1574), pour ne parler que des principaux, les avaient précédés depuis longtemps. Ensuite, l’origine espagnole de ce nouvel Ordre faisait difficulté en France qui avait été longtemps en guerre avec l’Espagne, ferme soutien de la Ligue pendant les guerres de religion.
L’Ordre du Carmel réformé n’était cependant pas inconnu à Paris, depuis l’arrivée en 1604 des Carmélites espagnoles, venues directement d’Espagne à l’initiative du Cardinal de Bérulle. La Régente Marie de Médicis voulait favoriser l’établissement des Fils de Thérèse d’Avila comme elle l’avait fait pour ses filles. De plus, la spiritualité des deux grands mystiques espagnols exerçait une véritable séduction en France dans les milieux dévots, notamment dans le salon de madame Acarie à Paris, qui deviendra elle-même Carmélite. Les œuvres de Sainte Thérèse d’Avila ont été traduites en français dès 1601. Pour ce qui est de saint Jean de la Croix, le Cantique spirituel est publié en français en 1610, avant même de l’être en espagnol ! Une première publication française de ses œuvres complètes aura lieu en 1621.
 Le couvent avec son église Saint Joseph des Carmes situé rue de Vaugirard est donc inauguré en 1611. Les carmes déchaux de Paris se rendront célèbres par la fabrication de l’eau de mélisse ou « eau des carmes ». L’expansion des Carmes Déchaux dans la France du XVIIe siècle fut importante. De 1608 (fondation du couvent d’Avignon) à 1635 (fondation de la Province de Paris), 18 couvents de Carmes déchaux ont été fondés sur le territoire de la France actuelle. A la fin du 17ème siècle, l’Ordre du Carmel déchaux compte 74 carmels féminins et 67 couvents de Carmes déchaux. Ce succès tient à l’équilibre original de cette vie conventuelle inspirée par le génie spirituel de la grande Thérèse qui articule trois éléments indissociables : la centralité de l’oraison vécue en commun durant deux heures chaque jour, l’importance de la vie fraternelle au sein de petites communautés qui favorisent les relations personnelles et un zèle missionnaire renouvelé, vécu aussi bien dans la prière pour l’Église que dans l’activité pastorale proprement dite.
Le couvent avec son église Saint Joseph des Carmes situé rue de Vaugirard est donc inauguré en 1611. Les carmes déchaux de Paris se rendront célèbres par la fabrication de l’eau de mélisse ou « eau des carmes ». L’expansion des Carmes Déchaux dans la France du XVIIe siècle fut importante. De 1608 (fondation du couvent d’Avignon) à 1635 (fondation de la Province de Paris), 18 couvents de Carmes déchaux ont été fondés sur le territoire de la France actuelle. A la fin du 17ème siècle, l’Ordre du Carmel déchaux compte 74 carmels féminins et 67 couvents de Carmes déchaux. Ce succès tient à l’équilibre original de cette vie conventuelle inspirée par le génie spirituel de la grande Thérèse qui articule trois éléments indissociables : la centralité de l’oraison vécue en commun durant deux heures chaque jour, l’importance de la vie fraternelle au sein de petites communautés qui favorisent les relations personnelles et un zèle missionnaire renouvelé, vécu aussi bien dans la prière pour l’Église que dans l’activité pastorale proprement dite.
La révolution française éradique l’Ordre en France. Le couvent des Carmes de la rue Vaugirard est transformé en prison pour les prêtres réfractaires du fait de la condamnation de la Constitution civile du Clergé par Pie VI en avril 1791. Le 2 septembre 1792, les commissaires de la section du Luxembourg organisent un simulacre de procès. Ils demandent à chaque prisonnier de prêter serment ; à chaque réponse négative, le prêtre est exécuté à l’arme blanche. Après deux heures, environ, 115 cadavres s’entassent dans le parc. Ils sont jetés dès le lendemain dans un puits ou dans le cimetière de Vaugirard. Ces hommes seront béatifiés en raison de leur martyre en 1926 : une association des martyrs en fait mémoire. En raison de leur popularité dans le quartier, aucun religieux carme ne se trouvait parmi eux, mais la communauté est ensuite définitivement dispersée. Le couvent sera occupé par une communauté de dominicains puis de carmélites avant d’être donné au diocèse de Paris qui l’élargira pour abriter l’Institut Catholique de Paris, le couvent du XVII° devenant le « Séminaire des Carmes » qui forme des séminaristes de différents diocèses français.
 La restauration du Carmel en France se fait difficilement au cours du 19e siècle. Le frère Dominique de Saint Joseph, Carme espagnol, chassé de son pays par les persécutions dont l’Église est l’objet, réalise en France la première réimplantation des Carmes en 1840, au Broussey, près de Bordeaux. Les frères reviennent à Paris et s’établissent dans plusieurs lieux de l’ouest parisien. Ils construisent l’église du Coeur Immaculé de Marie rue de la Pompe (aujourd’hui mission espagnole) en 1898 … mais sont expulsés de France en 1901. Après l’exil, les frères s’installent villa Scheffer puis villa de la Réunion en 1958 où ils resteront jusqu’en 2009. Après deux ans transitoires de logement à Montmartre à côté des carmélites, les Carmes de Paris sont installés depuis septembre 2011 rue Jean Ferrandi, à proximité de l’ancien couvent de la rue de Vaugirard.
La restauration du Carmel en France se fait difficilement au cours du 19e siècle. Le frère Dominique de Saint Joseph, Carme espagnol, chassé de son pays par les persécutions dont l’Église est l’objet, réalise en France la première réimplantation des Carmes en 1840, au Broussey, près de Bordeaux. Les frères reviennent à Paris et s’établissent dans plusieurs lieux de l’ouest parisien. Ils construisent l’église du Coeur Immaculé de Marie rue de la Pompe (aujourd’hui mission espagnole) en 1898 … mais sont expulsés de France en 1901. Après l’exil, les frères s’installent villa Scheffer puis villa de la Réunion en 1958 où ils resteront jusqu’en 2009. Après deux ans transitoires de logement à Montmartre à côté des carmélites, les Carmes de Paris sont installés depuis septembre 2011 rue Jean Ferrandi, à proximité de l’ancien couvent de la rue de Vaugirard.
Aujourd’hui dans le monde
Les carmes déchaux et les carmélites déchaussées, issues de la réforme de sainte Thérèse, sont aux nombres d’environ 4 000 frères et 10 000 sœurs sur les cinq continents. Des laïcs, au sein des Communautés carmélitaines vivant aussi de cette spiritualité, aident le Carmel à accomplir sa mission : guider les femmes et les hommes d’aujourd’hui sur les chemins de la prière et de la rencontre avec Dieu.